Peut-être l’avez-vous rencontré à jouer de son violon ou à conter une histoire sur scène ? Pétri de culture musicale vendéenne, Maxime est né à Valence dans la Drôme, sans avoir aucune racine drômoise. Son père travaillait à la SNCF. « Ça a l’avantage de la richesse de la diversité ; ça a l’inconvénient d’être de nulle part ». Saint Jean de Monts sera son premier port d’attache vendéen lorsqu’il a 20 ans. Depuis, il n’a jamais quitté la Vendée.
C’est en Pays Diois que Maxime participe à ses premières colonies. On est dans les années 70, l’époque des Stivell et Tri Yann dont le moniteur raffolait. « Il jouait de pleins d’instruments, dulcimer, vieille à roue…J’étais fasciné devant ce gars-là, marqué au fer rouge ». Une branche ancestrale bretonne figure dans la généalogie des Chevrier. « J’ai revendiqué ma bretonnitude très partielle » sourit-il.
Il poursuit les colonies, cette fois-ci en tant que moniteur. « Je me retrouve par hasard à Saint Jean de Monts. Monté dans un bus à Grenoble le soir, je me réveille le lendemain matin au bord de la mer ». La colo était rue du Vasais. À quelques encablures, une ferme du même nom abrite le groupe ‘Tap Dou Paï’ animé par Jean-Pierre Bertrand. « Le vendredi soir, nous emmenions les enfants au spectacle. Ça gavait tout le monde, sauf moi. C’est à cette époque que je commence le violon. Je rencontre Paul Grollier, un accordéoniste. On a commencé à jouer ensemble l’été ».
En parallèle, Maxime fait son BTS agricole à Melle en Deux-Sèvres. « Je suis devenu moniteur de maisons familiales la semaine, et le week-end je retrouvais mes copains musiciens vendéens. J’aimais ce métier, mais la musique a été plus forte ». Depuis, il est intermittent. Avec des hauts et des bas, mais sans le moindre regret. Il joue d’abord avec Yole. Puis le groupe Arbadétorne se forme à la fin des années 90, avec des apparitions régulières dans la grange du Puy du Fou. « Il a été mis fin à notre contrat il y a 5 ou 6 ans. Ça nous a donné un gros coup de pied au cul. Mais ça a permis de se poser les bonnes questions ».
Maxime en profite pour ressortir des cartons des projets en sommeil. « Il y a 30 ans j’avais commencé une petite activité de conteur. Ado, j’étais tombé sur une nouvelle de Maupassant « La mère aux monstres ». Elle raconte l’histoire d’une grossesse non désirée. Je me suis replongé dans tout Maupassant, et particulièrement sur l’évocation des femmes. Cela aboutit à mon spectacle ‘fantastique ! Monsieur Maupassant’ sous-titré ‘Femmes en lutte et chienne de vie’ ».
Le Panthéon personnel de Maxime est fait de gens d’ici, méconnus. « Hubert Martin du pays de Pouzauges avait 90 ans lorsque je l’ai rencontré. Peut-être le dernier locuteur si patoisant. Le patois était sa langue naturelle. Hubert est probablement mon arrière-grand-père de culture ». L’autre rencontre marquante, c’est Eglantine Vivien. « L’épouse de Georges Vivien violoneux mythique de Rochetrejoux. Elle avait 100 ans quand je l’ai rencontrée avec un tempérament affirmé et un regard affûté sur la place de la femme en milieu rural ». Sans oublier son moniteur de colo, branché folk.
Le festival ‘Bouche à oreilles’ lui avait proposé il y a quelques années de conter son portrait. « J’avais un truc à dire, c’était l’histoire du ‘choix’. Les choix qu’on fait, ou qu’on ne fait pas mais qu’il faut assumer comme l’homosexualité. Il faut très longtemps pour assumer un choix que tu n’as pas fait ». L’autre choix, c’est celui de son lieu de vie. « Je mets mes pieds sur terre à cet endroit-là et je me choisis une famille qui ne sera pas ma famille de sang, mais la famille du cœur, tout au moins de culture ».
Sa météo personnelle laisse apparaître quelques nuages. « On est en train de gâcher cette belle planète. Ça me révolte. Avec ce que je sais faire, raconter des histoires, j’essaie de sensibiliser les jeunes publics. La notion du bien et du mal est subjectivement humaine. La nature s’en fiche de ces notions ».
Des histoires inspirées par ses lectures et ses recherches. « Je suis sensible à ce rapport aux anciens, aux messages qu’ils nous laissent à travers les archives ». Et le drômois vendéen de conclure : « Tout le monde pense que je suis de là depuis tout le temps ! Les bocains disent que je suis maraîchin et inversement. Ce qui est sûr c’est que j’ai trouvé mon pays d’accueil ici ».

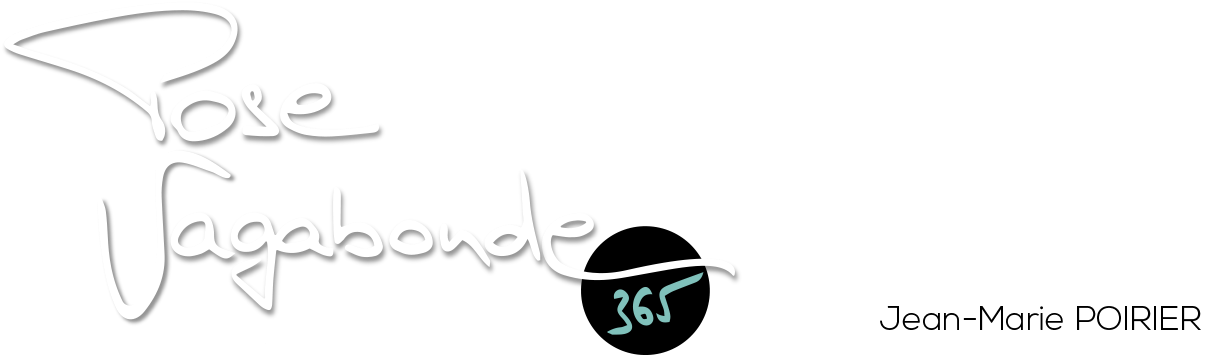
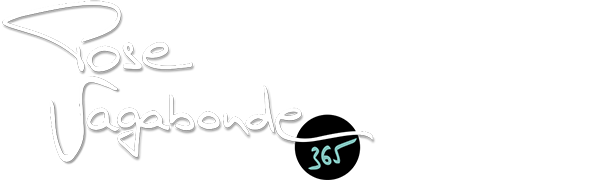







Leave A Comment